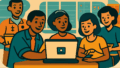[Avertissement] Cet article a été reconstruit à partir d’informations provenant de sources externes. Veuillez vérifier la source originale avant de vous y référer.
Résumé de l’actualité
Le contenu suivant a été publié en ligne. Un résumé traduit est présenté ci-dessous. Consultez la source pour plus de détails.
Ngũgĩ wa Thiong’o, l’un des écrivains africains les plus célébrés, continue d’influencer profondément la littérature à travers l’Afrique francophone, bien qu’il écrive principalement en anglais et en gikuyu. Né au Kenya en 1938, Ngũgĩ a pris une décision révolutionnaire en 1977 d’arrêter d’écrire en anglais et d’utiliser à la place sa langue maternelle, le gikuyu, affirmant que les écrivains africains devraient communiquer avec leur propre peuple dans leurs propres langues. Cette position audacieuse a profondément résonné auprès des écrivains africains francophones confrontés à des dilemmes similaires concernant l’écriture en français ou dans les langues autochtones. Son œuvre majeure “Décoloniser l’esprit” a été traduite en français et est largement étudiée dans les universités du Sénégal à Madagascar. Les auteurs africains francophones créditent Ngũgĩ d’avoir légitimé leurs propres luttes avec l’identité linguistique et d’avoir inspiré des mouvements pour publier dans des langues comme le wolof, le bambara et le lingala. Son influence s’étend au-delà de la politique linguistique, touchant aux thèmes de la résistance, de l’identité et du rôle de la littérature dans le changement social. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’écrivains africains francophones reconnaît ouvertement l’impact de Ngũgĩ sur leur décision d’expérimenter l’écriture multilingue et de remettre en question la domination des langues européennes dans la littérature africaine.
Source : Global Voices
Notre commentaire
Contexte et arrière-plan

Imaginez-vous contraint d’exprimer vos pensées et vos histoires les plus profondes dans une langue qui n’est pas la vôtre. C’est la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux écrivains africains, qui ont hérité des langues européennes du colonialisme. Ngũgĩ wa Thiong’o a remis en question ce système en passant de l’anglais à sa langue maternelle, le gikuyu, déclenchant une révolution littéraire qui se poursuit aujourd’hui.
Pendant la période coloniale, les puissances européennes ont imposé leurs langues aux pays africains – l’anglais au Kenya et au Nigéria, le français au Sénégal et en Côte d’Ivoire, le portugais au Mozambique. Après l’indépendance, ces langues sont restées dominantes dans l’éducation, le gouvernement et la littérature, créant un paradoxe : des écrivains africains racontant des histoires africaines dans des langues européennes que de nombreux Africains ne pouvaient pas lire.
Analyse d’expert
L’impact de Ngũgĩ sur l’Afrique francophone est particulièrement fascinant car il transcende les barrières linguistiques. Les écrivains africains francophones sont confrontés à des dilemmes similaires : devraient-ils écrire en français pour atteindre un public international ou dans des langues locales pour se connecter avec leurs communautés ? Ngũgĩ a fourni un exemple puissant selon lequel le choix des langues autochtones n’est pas seulement possible, mais révolutionnaire.
Son influence va au-delà du choix de la langue. Ngũgĩ a démontré que la littérature pouvait être un outil de changement politique et social. Ses pièces de théâtre, jouées dans les villages, ont amené le théâtre à des gens qui n’avaient jamais mis les pieds dans un théâtre conventionnel. Cette approche a inspiré les écrivains francophones à voir la littérature non pas comme une poursuite élitiste, mais comme une expérience communautaire.
Données supplémentaires et faits
Les chiffres racontent une histoire convaincante. Bien que le français soit une langue officielle dans 29 pays africains, seulement environ 30% de la population de ces pays parle couramment le français. Cela signifie que la littérature écrite en français n’atteint souvent pas la majorité des gens. Pendant ce temps, des langues comme le wolof (parlé par 10 millions de personnes), le bambara (15 millions) et le lingala (25 millions) ont une littérature publiée limitée.
Les livres de Ngũgĩ ont été traduits dans plus de 30 langues, dont le français, démontrant que l’écriture dans une langue africaine ne limite pas la portée internationale. Son roman “Le Sorcier du Corbeau”, initialement écrit en gikuyu, est devenu un best-seller mondial après sa traduction.
Actualités connexes
Ce débat linguistique reste très pertinent. En 2023, l’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop a publié un roman en wolof qui s’est mieux vendu que de nombreux livres en français. Des auteurs congolais créent des bandes dessinées en lingala. Les plateformes numériques permettent désormais aux écrivains de publier simultanément dans plusieurs langues, rendant la vision de Ngũgĩ plus réalisable.
L’Union africaine a déclaré 2025-2035 la “Décennie des langues africaines”, en partie inspirée par des défenseurs comme Ngũgĩ. Les entreprises technologiques développent des claviers et des outils de traduction pour les langues africaines, ce qui pourrait révolutionner la littérature numérique.
Résumé

L’influence de Ngũgĩ wa Thiong’o sur la littérature africaine francophone prouve que les idées révolutionnaires transcendent les barrières linguistiques. En choisissant d’écrire en gikuyu, il n’a pas seulement changé sa propre carrière – il a inspiré des écrivains à travers l’Afrique à reconsidérer leur relation avec la langue et le public. Son héritage nous rappelle que le pouvoir de la littérature ne réside pas dans la langue utilisée, mais dans sa capacité à dire la vérité au pouvoir et à toucher les cœurs des gens.
Réaction publique
Les jeunes écrivains africains francophones citent de plus en plus Ngũgĩ comme source d’inspiration, de nombreux d’entre eux tentant la publication bilingue. Les étudiants universitaires à travers l’Afrique francophone étudient ses œuvres dans les cours de littérature et de philosophie. Certains auteurs francophones établis critiquent ce mouvement comme étant irréaliste, affirmant que le français offre un accès aux marchés mondiaux. Les éditeurs signalent une demande croissante pour les livres dans les langues africaines, bien que la distribution reste un défi.
Questions fréquentes
Q : Qui est Ngũgĩ wa Thiong’o ?
R : C’est un écrivain kenyan né en 1938 qui a révolutionné la littérature africaine en choisissant d’écrire dans sa langue maternelle, le gikuyu, plutôt qu’en anglais, inspirant les écrivains du monde entier à valoriser les langues autochtones.
Q : Pourquoi le choix de la langue est-il si important pour les écrivains africains ?
R : La langue relie les écrivains à leur public. Écrire dans des langues européennes signifie souvent exclure la majorité qui parle des langues autochtones, tandis qu’écrire dans des langues locales préserve la culture mais peut limiter la portée internationale.
Q : Comment les étudiants peuvent-ils lire les œuvres de Ngũgĩ ?
R : De nombreux de ses livres sont traduits dans plusieurs langues. Commencez par “Décoloniser l’esprit” pour ses idées sur la langue, ou ses romans comme “Le Sorcier du Corbeau” pour ses talents de conteur.