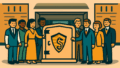[Avertissement] Cet article a été reconstruit à partir d’informations provenant de sources externes. Veuillez vérifier la source originale avant de vous y référer.
Résumé de l’actualité
Le contenu suivant a été publié en ligne. Un résumé traduit est présenté ci-dessous. Consultez la source pour plus de détails.
Le 22 juillet 2025, les États-Unis ont officiellement notifié à la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, leur décision de se retirer de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le Département d’État a cité plusieurs raisons, notamment l’accent mis par l’UNESCO sur ce qu’il a qualifié de causes culturelles divisives, l’accent mis sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies en conflit avec les politiques “Amérique d’abord”, et l’admission de la Palestine en tant qu’État membre de l’organisation. Le retrait prendra effet le 31 décembre 2026, conformément aux exigences constitutionnelles de l’UNESCO. D’ici là, les États-Unis restent membres à part entière. Il s’agit de la deuxième fois que les États-Unis se retirent de l’UNESCO, après l’avoir précédemment quittée en 1984 et y être revenus en 2003, avant de s’en retirer à nouveau en 2017 et d’y revenir en 2023.
Source : Département d’État américain
Notre commentaire
Contexte et arrière-plan
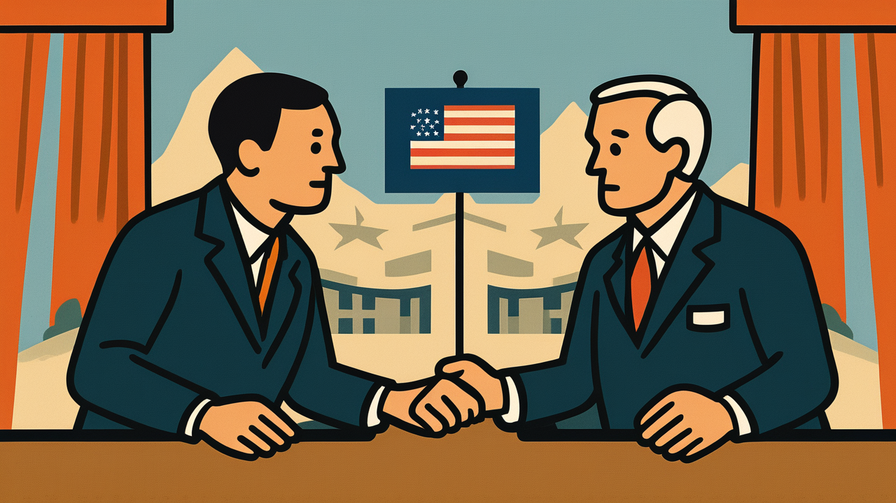
L’UNESCO est l’acronyme de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Imaginez-la comme un club mondial où les pays travaillent ensemble pour protéger des sites historiques importants (comme les pyramides en Égypte), promouvoir l’éducation pour tous les enfants et préserver les traditions culturelles.
Fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, la mission de l’UNESCO est de construire la paix par la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture. Elle est chargée de désigner les sites du patrimoine mondial – des lieux spéciaux protégés pour toute l’humanité, comme le Grand Canyon ou la Grande Muraille de Chine.
Les États-Unis ont entretenu une relation intermittente avec l’UNESCO. Les pays quittent parfois des organisations internationales lorsqu’ils sont en désaccord avec les décisions prises ou pensent que leurs intérêts ne sont pas servis. C’est comme quitter un club lorsqu’on n’est pas d’accord avec les nouvelles règles ou la nouvelle orientation.
Analyse d’expert
L’annonce du Département d’État reflète des changements plus larges dans la politique étrangère américaine. L’approche “Amérique d’abord” mentionnée donne la priorité aux intérêts nationaux plutôt qu’à la coopération internationale. Cette philosophie remet en question le fait que les engagements internationaux bénéficient directement aux citoyens américains.
La question de l’adhésion de la Palestine a été source de tensions depuis 2011, lorsque l’UNESCO a admis la Palestine en tant qu’État membre. Les États-Unis et Israël s’y sont fortement opposés, arguant que cela préjugeait des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Cela a conduit les États-Unis à cesser de financer l’UNESCO, la loi américaine interdisant le financement des agences des Nations Unies qui reconnaissent la Palestine comme un État.
La référence aux “Objectifs de développement durable” (ODD) reflète un désaccord sur les priorités du développement mondial. Les ODD comprennent des objectifs comme la fin de la pauvreté, la garantie d’une éducation de qualité et la lutte contre le changement climatique – des objectifs que certains considèrent comme une coopération mondiale importante, tandis que d’autres les perçoivent comme l’imposition d’obligations coûteuses.
Données supplémentaires et faits
L’UNESCO gère 1 199 sites du patrimoine mondial répartis dans 168 pays. Aux États-Unis, cela inclut 24 sites comme le parc national de Yellowstone, la Statue de la Liberté et Mesa Verde. Même après le retrait, ces désignations resteront, bien que les États-Unis ne participent pas à de nouvelles nominations.
Les États-Unis ont précédemment contribué à hauteur d’environ 22% du budget de l’UNESCO, soit environ 80 millions de dollars par an. Lorsque les États-Unis ont cessé de payer en 2011, cela a créé d’importants défis financiers pour les programmes de l’UNESCO, notamment les initiatives d’alphabétisation et la coordination de la recherche scientifique.
La période de retrait de deux ans permet une transition en douceur. Pendant ce temps, les experts américains siégeant dans les comités de l’UNESCO achèveront leurs mandats, et les projets en cours impliquant des institutions américaines seront conclus ou transférés.
Actualités connexes
Ce retrait s’inscrit dans une remise en question plus large des engagements internationaux des États-Unis. Des débats similaires ont lieu concernant les accords sur le climat, les organisations commerciales et les alliances militaires. Chacun reflète les tensions entre la coopération internationale et la souveraineté nationale.
D’autres membres de l’UNESCO, notamment les pays européens et le Japon, ont exprimé leur déception, faisant valoir que les défis mondiaux nécessitent des solutions multilatérales. La Chine a indiqué qu’elle pourrait accroître son implication dans l’UNESCO, comblant potentiellement le vide de leadership.
Résumé

Le retrait des États-Unis de l’UNESCO représente un changement significatif dans la manière dont l’Amérique s’engage dans la coopération culturelle et éducative internationale. Bien que le Département d’État présente cela comme une protection des intérêts américains, les critiques craignent que cela ne réduise l’influence des États-Unis dans l’éducation et la culture mondiales. Cette décision met en lumière les débats en cours sur la question de savoir si les pays tirent davantage avantage de leur participation au sein d’organisations internationales pour les réformer ou de leur retrait en cas de désaccords. Pour les jeunes intéressés par les relations internationales, ce cas d’étude montre comment les décisions de politique étrangère impliquent de peser les valeurs et les intérêts concurrents.
Questions fréquentes
Les Américains pourront-ils toujours visiter les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO ? Oui, le retrait n’affecte pas le tourisme. Les Américains peuvent toujours visiter tous les sites du patrimoine mondial dans le monde, et les sites américains existants conservent leur désignation.
Qu’advient-il des étudiants américains dans les programmes de l’UNESCO ? Les échanges éducatifs et les programmes en cours se poursuivront jusqu’à la date du retrait. Après 2026, les étudiants américains devront peut-être participer par le biais d’organisations non gouvernementales ou d’établissements universitaires.
Les États-Unis pourraient-ils rejoindre l’UNESCO à nouveau à l’avenir ? Oui, les États-Unis l’ont déjà fait par le passé. Les futures administrations pourraient décider de rejoindre l’organisation si elles estiment que cela sert les intérêts américains et si les États membres approuvent le retour.